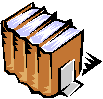 Revue de littérature
Revue de littérature 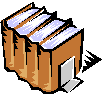
La problématique malheureusement très présente des enlèvements, et principalement des enlèvements internationaux d’enfants par un des parents, semble faire couler beaucoup d’encre et ouvrir la porte à de nombreux débats. D’ailleurs, la communauté internationale a dû se pencher sur ce phénomène afin de réaliser l’ampleur de ce fléau et de trouver des solutions pour l’enrayer. C’est par la Conférence de La Haye sur le droit international privé, qui est une organisation internationale siégeant aux Pays-Bas depuis plusieurs années, que les différents pays du globe ont collaboré pour améliorer ce problème. En 1976, le Canada faisait part d’une proposition à la Conférence de La Haye en rapport avec le phénomène bien particulier de la garde et de l’enlèvement d’enfants. Après de nombreux débats et négociations, on en vient, en 1983, à mettre en vigueur la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Cette convention s’applique autant au Canada que dans les 52 autres pays qui ont signé cette convention.
Les principaux objectifs de la Convention de La Haye sont d’ « assurer le retour rapide, dans le milieu d’où ils ont été enlevés, des enfants emmenés ou retenus illicitement dans tout État signataire » et de « faire respecter effectivement dans les États signataires les droits de garde et de visite en vigueur dans l’un de ces États » (Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, 1998). Il y a par contre des conditions qui doivent être présentes afin de pouvoir profiter de la Convention. En effet, l’enfant devait demeurer officiellement au Canada avant d’être enlevé et l’enlèvement doit enfreindre un droit de garde ou de visite attribué par un tribunal. De plus, la Convention doit également être en vigueur dans le pays où l’enfant, qui doit avoir moins de 16 ans, est retenu contre son gré. Finalement, l’enlèvement doit avoir eu lieu au cours de la dernière année.
Il fallait s’y attendre, malgré le bel effort que constitue la Convention de La Haye il n’en reste pas moins que les démarches sont longues et pénibles pour obtenir le retour de son enfant au Canada. Parfois, la législation ou les valeurs en vogue dans un autre pays font en sorte qu’il est pratiquement impossible de rapatrier l’enfant ici. Prenons l’exemple du cas de la conjointe du député Bigras. Son fils de 3 ans est retenu en Égypte par son père. Dans ce pays, la femme n’a des droits sur ses enfants que si elle est mariée au père de ces derniers. De plus, il semble que la parole d’une femme, devant un tribunal, ne vaut que la moitié de la parole d’un homme. Cette pauvre femme peut donc aller voir son enfant dans le pays d’origine du père, mais elle ne peut pas le faire sortir en dehors de l’Égypte pour le ramener au Canada.
Bien que les enlèvements
internationaux occupent une grande place médiatique, il ne faut pas oublier
qu’il existe d’autres types d’enlèvement au Canada qui n’impliquent pas que la
victime soit retenue dans un pays étranger.
Effectivement, on constate qu’il y a différents types d’enlèvement, notamment
ceux qui sont en contravention ou en l’absence d’une ordonnance de garde, les
enlèvements d’une personne de moins de 14 ans ou de moins de 16 ans, ainsi que
l’enlèvement et/ou la séquestration. Toutes ces catégories seront explicitées
plus loin lorsqu’il sera question de la définition légale de l’infraction. Pour
l’instant, concentrons-nous principalement sur l’enlèvement parental qui est le
type d’enlèvement qui est davantage présent dans la littérature.
Les études sur l’enlèvement démontrent qu’à travers le monde entre 1.5 à 1.8 millions d’enfants sont portés disparus. Parmi ces enfants, entre 25 000 et 100 000 proviennent des États-Unis. Au Canada, il y a en moyenne 2 000 enfants qui sont enlevés par un de leur parent annuellement (Tambu, 1991).
Chaque année au Canada plusieurs cas d’enfants disparus sont signalés. Pour l’année 1996, on a dénombré 56 000 cas dont 78% (43 680) s’avéraient être des fugues (Juristat, 1998). On peut constater que l’enlèvement par les parents ou bien un inconnu ne constitue donc qu’une infime partie de tous les cas d’enfants disparus. Le nombre de fugueurs a quand même considérablement diminué durant les années; une étude de Fisher en 1989 démontrait que les fugueurs comptaient pour 86% de tous les enfants disparus et que 3% des enfants étaient enlevés par un inconnu (1%) ou par un des parents (2%).
Parmi les enfants enlevés, il y en a environ 400 enfants qui sont enlevés par un de leur parent et qui sont amenés à l’étranger à chaque année. Depuis 1996, un programme a été mis en place afin de rendre plus difficile l’exécution de ce genre d’enlèvement. Un enfant qui est enlevé et emmené à l’étranger est plus difficile à retrouver et à rapatrier au pays. C’est pourquoi ce programme fait en sorte qu’il soit plus difficile pour une personne de quitter le pays avec un enfant sans avoir l’autorisation de l’autre parent. Voici quelques précautions qui doivent être prises par un parent qui voyage avec un enfant dans les aéroports internationaux:
· Tous les adultes devraient avoir une pièce d’identité appropriée pour les enfants qui voyagent en leur compagnie, peu importe l’âge de l’enfant.
· Une pièce d’identité appropriée peut être un certificat de naissance, un baptistère, un passeport, une carte de citoyenneté, un document d’immigrant reçu ou un Certificat du statut d’Indien.
· Les parents qui ont la garde partagée de leurs enfants devraient avoir une copie des documents de garde légale.
· Tout adulte qui n’est pas le père, la mère ou le tuteur de l’enfant devrait avoir la permission écrite du père, de la mère ou du tuteur pour superviser l’enfant, ainsi qu’une pièce d’identité de ce dernier. Cette lettre de permission devrait contenir les adresses et les numéros de téléphones où l’on peut rejoindre le père, la mère ou le tuteur de l’enfant.
· Lorsque les gens voyagent en groupe de véhicules, les enfants devraient se trouver dans la même voiture que leur père, leur mère ou leur tuteur au moment d’arriver à la frontière.
Comme on peut le remarquer, ce fameux programme a instauré plusieurs critères pertinents qui rendent ainsi l’enlèvement international d’enfants plus difficile qu’auparavant. « Si cette attention supplémentaire retarde quelque peu les formalités, elle contribue néanmoins à assurer la sécurité des enfants » (Enlèvements internationaux d’enfants).
Différentes recherches ont également porté sur les principales caractéristiques des enfants enlevés. À ce sujet, le Dr Michael Agopian, qui est un chercheur de la California Lutherance College, a étudié 91 dossiers d’enfants enlevés par leur parent (130 enfants en tout). Son centre de recherche (Child Stealing Research Center) a démontré que la plupart des enfants enlevés étaient âgés entre 3 et 11 ans. Parmi les enfants étudiés, 5% étaient âgés de moins de 3 ans, 34% avaient entre 3 et 5 ans, 22% avaient entre 6 et 8 ans, 26% avaient entre 9 et 11 ans et 13 % étaient âgés de 12 ans et plus (Tambu, 1991). Comparativement aux statistiques d’Agopian qui concernent les États-Unis, au Canada, en 1996, c’était la moitié des enfants enlevés qui avaient 14 et 15 ans, 23% avaient 16 et 17 ans, 21% avaient 12 et 13 ans et les autres (6%) avaient moins de 11 ans.
Pour ce qui est du Canada, les recherches démontrent que les enfants plus jeunes sont moins susceptibles d’être enlevés que les enfants plus âgés. Effectivement, les bambins comme les nourrissons nécessitent beaucoup plus de soins que les jeunes adolescents âgés entre 12 et 15 ans. En 1996, les recherches ont démontré que 72% des personnes portées disparues avaient 14 ans et plus. Parmi ces jeunes personnes enlevées, les filles étaient plus susceptibles d’être victimes d’enlèvement. En 1996, 58% des personnes enlevées étaient des filles. De plus, elles étaient plus souvent victimes de rapts non parentaux (66%) (Juristat, 1998).
Pour ce qui est des caractéristiques spécifiques aux ravisseurs, il est démontré qu’ils sont plus souvent des hommes que des femmes. Ce qui distingue les femmes qui enlèvent des enfants des hommes, c’est que celles-ci ont tendance à garder les enfants plus longtemps. Les hommes sont plus souvent les kidnappeurs puisque dans la majorité des cas les femmes n’ont pas besoin d’enlever leurs enfants parce qu’elles ont majoritairement la garde légale. Les ravisseurs de sexe masculin ont également davantage tendance à enlever des jeunes filles que des jeunes hommes.
Il est également intéressant de savoir quelles sont les raisons qui poussent un parent à kidnapper son enfant. Plusieurs raisons peuvent être énumérées pour des rapts parentaux et, dans son rapport, G. Tambu (1991) expliquent ces diverses causes qui peuvent expliquer un tel comportement. Il nous dit que les enlèvements peuvent subvenir avant, pendant ou après les procédures de divorce ou de séparation. Les individus qui commettent des enlèvements parentaux le font souvent par vengeance envers la personne qui les a quittés. Les ravisseurs sont, bien entendu, ceux qui n’ont pas reçu la garde de l’enfant. Donc, à travers l’enfant, les ravisseurs essayent de punir l’autre parent qui a demandé le divorce ou qui a reçu la garde légale de leur enfant. Les recherches démontrent également que certains indices peuvent être détectés avant la commission du rapt :
· On constate une longue accumulation de retards;
· Il y a de plus en plus de chicanes;
· Il y a obstruction sous plusieurs prétextes qui empêchent le contact entre le parent qui visite et l’enfant;
· L’accumulation des menaces et des craintes qui rendent le parent gardien encore plus rigide envers le droit de visite de l’autre parent.
Ces quatre items ne sont que des exemples qui démontrent que le parent est prêt à enlever l’enfant. Maintenant, voici les quatre principaux facteurs qui peuvent motiver l’enlèvement:
· L’idée que l’enfant peut être négligé ou risque de l’être par la personne ayant la garde ou la charge de l’enfant;
· Désir de punir l’ex-conjoint(e) après un échec dans la relation;
· Le désir de poursuivre à temps plein le rôle de parent (n’accepte pas d’avoir une garde partagée);
· La tentation de susciter le retrait de la demande de divorce ou de tenter la réconciliation (Tambu, 1991).
Dans quelques cas, l’enlèvement n’est pas
issu d’un sentiment de vengeance ou d’égoïsme mais pour l’intérêt et le
bien-être de l’enfant. Par contre, même dans ces cas-ci, l’enlèvement peut
avoir diverses conséquences sur les enfants. La plupart des chercheurs
s’entendent sur le fait que les enfants victimes d’enlèvement subissent un
traumatisme réel qui peut les affecter jusqu'à l’âge adulte. L’événement laisse
autant plus de séquelles quand le ravisseur est un parent puisque l’acte est
commis par quelqu’un en qui l’enfant avait confiance. Les sentiments que les
enfants ressentent plus souvent sont la peur, la tristesse, la solitude et
l’hystérie au moment de l’enlèvement ainsi qu’un sentiment de vulnérabilité et
de confusion.
Les liens parentaux sont aussitôt détériorés puisque l’enfant éprouve un sentiment de rejet envers le parent qui est absent et un sentiment de colère envers le parent ravisseur. Souvent les enfants subissent des lavages de cerveau, ce qui explique les sentiments qu’il peut éprouver envers le parent absent. Le ravisseur peut constamment répéter à l’enfant que s’il l’a emmené loin c’est que l’autre parent ne voulait plus de lui et qu’il ne l’aime plus. Mais ce ne sont pas tous les enfants qui subissent le même degré de traumatisme. En effet, il y a différents facteurs qui entrent en ligne de compte, tels l’âge de l’enfant au moment de l’enlèvement, le traitement subi durant l’enlèvement, la durée de l’enlèvement, le style de vie et l’expérience durant l’enlèvement et le genre de support et de thérapie fournis après le retour. Pour un enfant de moins de cinq ans, l’événement peut être extrêmement nuisible alors que pour un enfant de plus de cinq ans cela peut provoquer un changement et même mener à un ressentiment envers les parents. Le manque de stabilité peut aussi affecter l’enfant dans ses relations interpersonnelles futures.
Finalement,
abordons un sujet plus précis aux enlèvements eux-mêmes, c’est-à-dire le lieu
et le moment des enlèvements. La plupart des enlèvements se produisent la fin
de semaine. Comme les dates des visites sont souvent allouées à ce moment, les
parents ravisseurs profitent de cette opportunité pour commettre leur acte. Les
statistiques démontrent également que la moitié des enlèvements se sont
produits durant les périodes prévues par le tribunal. La majorité des rapts se
produisent dans le foyer des enfants kidnappés, 12% se produisent à l’école et
18% se produisent dans la rue. Dans la majorité des cas, il y a un témoin à
l’événement et ce témoin est souvent l’autre parent qui se retrouve bien
souvent impuissant devant la situation (Tambu,1991).