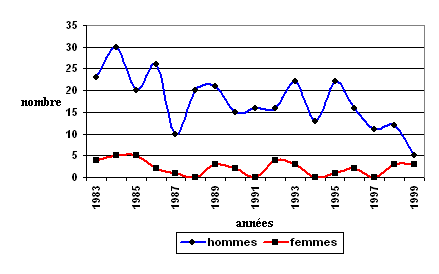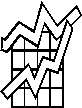 Analyse
des tendances de l’enlèvement
Analyse
des tendances de l’enlèvement 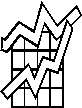
au Canada et au Québec
Le projet de loi C-127, décrété en 1983, a amené des modifications importantes dans la façon de traiter les cas d’enlèvement. Il existe maintenant deux types de rapts parentaux (avec ou sans ordonnance de garde). On retrouve aussi le rapt de personnes de moins de 14 ans, le rapt d’une personne non mariée de moins de 16 ans et l’enlèvement tel que connu dans la législation. Pour analyser les tendances de cette criminalité, chacun des différents types d’enlèvement sera observé pour le Canada ainsi que pour le Québec afin d’avoir une meilleure vue d’ensemble du phénomène. Cependant, dans notre analyse, les années précédant 1983 n’ont pas été retenues à cause du manque trop important de données. Nous ne pourrons donc pas mesurer l'impact des changements législatifs survenus en 1983. De plus, le cas des suspects juvéniles a également été exclu pour la même raison.
1) Enlèvements d’une personne de moins de 14 ans
Ce type d’enlèvement réfère aux personnes qui enlèvent un enfant de moins de 14 ans alors qu’elles ne sont ni le père, ni la mère ou le tuteur de cet enfant. Les graphiques suivants illustrent bien la distribution du nombre d’enlèvements d’une personne de moins de 14 ans qui se sont produits au Canada et au Québec entre 1983 et 1999.
Graphique 1 : Distribution du nombre d’enlèvements d’une personne de moins de 14 ans
au Canada entre 1983 et 1999
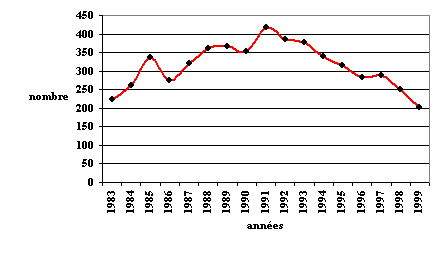
On peut constater qu’entre 1983 et 1991, au Canada, ce type d’enlèvement était en croissance relativement constante. C’est en 1991 que ce comportement a atteint son apogée pour ensuite subir une décroissance continue jusqu’en 1999. En examinant le taux d’enlèvement par 100 000 habitants (vous pouvez trouver une description exhaustive des taux dans le tableau en annexe 1) on peut constater que c’est en 1991 qu’il y a eu le plus haut taux d’enlèvement (1.49 enlèvements par 100 000 habitants). Comme la distribution du graphique 1 le démontre, les taux d’enlèvements au Canada ont accusé une croissance, suivie d’une décroissance en 1991 pour atteindre leur niveau le plus bas en 1999 (0.67 enlèvement par 100 000 habitants)
Graphique 2 : Distribution du nombre d’enlèvements d’une personne de moins de 14 ans
au Québec entre 1983 et 1999
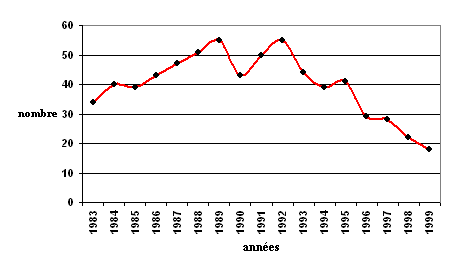
Au Québec, la même tendance peut être remarquée que pour l’ensemble du Canada dans les cas d’enlèvements de personnes de moins de 14 ans. C’est en 1989 et 1992 que ce type de crime atteint son plus haut niveau (55 enlèvements). À partir de 1992, le nombre d’enlèvements de personnes de moins de 14 ans subit une décroissance plutôt constante alors qu’en 1999 le nombre d’enlèvements atteint son plus bas niveau depuis 1983, soit de 18 cas seulement. Pour le Québec, c’est en 1989 qu’on pouvait retrouver le plus haut taux d’enlèvements, soit un taux équivalant à 0,79 enlèvement par 100 000 habitants suivi de près par un taux de 0,77 enlèvement par 100 000 habitants en 1992. Le plus bas taux (en 1999) était de 0,24 enlèvement par 100 000 habitants.
Une autre analyse qui peut être intéressante de réaliser avec les données que nous avons amassées pour la présente section du travail serait de regarder la proportion d’enlèvements de personnes de moins de 14 ans qui ont été commis par des hommes ou par des femmes. Il est important de rappeler que notre étude ne portera pas sur les suspects mineurs. En effet, lors de la cueillette des données, nous nous sommes aperçues que de nombreuses informations étaient manquantes. Pour cette raison, ajouté au fait que très peu de juvéniles commettent ce genre de crime, nous avons décidé de ne pas tenir compte de cette catégorie de personne dans notre analyse.
Nous l’avons constaté dans la revue de littérature, les hommes sont plus souvent les auteurs d’enlèvements que les femmes. Regardons à l’aide des graphiques suivants si la situation est telle au Canada et au Québec. Les graphiques 3 et 4 nous donnent donc un aperçu de la distribution du nombre de suspects masculins et féminins dans les cas d’enlèvements d’une personne de moins de 14 ans.
Graphique 3 : Distribution du nombre de suspects qui ont commis un enlèvement d’une personne
de moins de 14 ans, selon le sexe, au Canada de 1983 à 1999
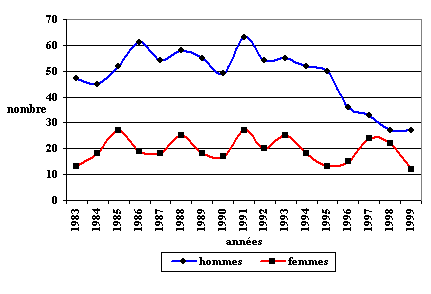
Graphique 4 : Distribution du nombre de suspects qui ont commis un enlèvement d’une personne
de moins de 14 ans au Québec de 1983 à 1999
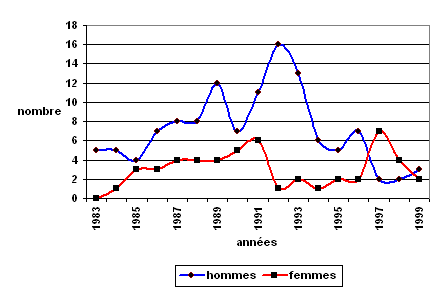
Il est plutôt évident, en fait pour ce qui est de la situation de tout le Canada, que les hommes commettent un plus grand nombre d’enlèvements de personnes de moins de 14 ans que les femmes. De plus, le nombre de suspects, autant masculins que féminins n’accuse pas de fluctuations importantes.
Par contre, pour ce qui est plus particulièrement du Québec, on remarque que le nombre de suspects masculins fluctue énormément. On peut même voir qu’à la fin des années 1990, le nombre de suspects féminins dépasse celui du sexe opposé. en 1999, le nombre d’hommes accusés d’enlèvement d’une personne de moins de 14 ans est sensiblement le même que pour les femmes accusées du même crime. Par contre, il est difficile de conclure à une véritable tendance, puisque le nombre de suspects est relativement bas pour cette infraction, au Québec.
Nous allons maintenant observer la distribution des enlèvements de personnes de moins de 14 ans qui ont été solutionnés, soit par mise en accusation ou sans mise en accusation, pour le Canada et ensuite pour le Québec plus précisément. Nous aurions pu faire la distribution du taux d’enlèvements solutionnés et non solutionnés, mais nous trouvions plus intéressant de voir de quelle manière les infractions avaient été solutionnées, particulièrement pour notre analyse des enlèvements parentaux.
Graphique 5 : Distribution des enlèvements d’une personne de moins de 14 ans qui ont été
solutionnés avec ou sans mise en accusation au Canada de 1983 à 1999
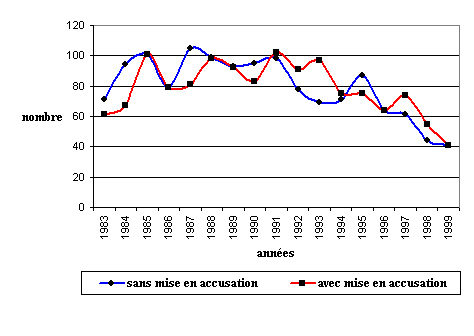
Pour ce qui est du pourcentage de résolution de cette catégorie d’enlèvement, si on réfère au tableau en annexe 1, on constate que près de la moitié des crimes sont solutionnés à chaque année. Le pourcentage de crimes solutionnés va de 39.6% à 61.7%, se tenant en moyenne autour de 50%. Si on compare les deux catégories de classement des infractions pour le Canada, il est difficile d’en faire ressortir une tendance puisque ces dernières se chevauchent constamment. Parfois les enlèvements de personnes de moins de 14 ans sont davantage classés par mise en accusation alors que d’autres fois, c’est le contraire qui survient. Ce graphique démontre tout de même que le nombre d’enlèvements solutionnés est relativement à la baisse depuis le début des années 1990, au Canada. Il est clair que le fait que le nombre total des infractions de cette catégorie diminue entraîne évidemment cette tendance à la baisse qu’accuse la courbe des crimes solutionnés. Par contre, le taux de résolution, pour sa part, demeure plutôt constant, ce qui nous amène par contre à soulever l’hypothèse qu’il pourrait être plus difficile pour les policiers de solutionner ce type de crime, et ce, malgré la diminution du nombre d’incidents.
Graphique 6 : Distribution des enlèvements d’une personne de moins de 14 ans qui ont été
solutionnés avec ou sans mise en accusation au Québec de 1983 à 1999
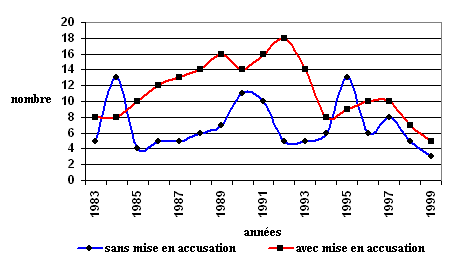
Pour le Québec, on remarque que la situation est différente, autant pour ce qui est du pourcentage de résolution des crimes que pour ce qui est des tendances observées selon le mode de résolution. En effet, sauf quelques exceptions (en 1984 et 1995), la plupart des enlèvements de personnes de moins de 14 ans sont solutionnés par mise en accusation. Par contre, on constate que le nombre de crimes solutionnés semble également tendre vers le bas depuis le début des années 1990, tout comme pour ce qui est du Canada en entier. Pour le Québec, on peut également remarquer que le pourcentage de résolution des enlèvements d’une personne de moins de 14 ans est un peu plus bas que pour le Canada. En effet, les taux vont de 35.9% à 64.3%, mais se situent en moyenne autour de 46%.
2) Enlèvements d’une personne de moins de 16 ans
En comparant le Québec et le Canada, on s’aperçoit que les enlèvements de personnes de moins de 16 ne suivent pas exactement la même tendance. Au Canada (comme pour les enlèvements des personnes de moins de 14 ans) c’est au début des années 1990 que la tendance commence à prendre une pente descendante. Malgré le fait que la baisse n’est pas faite de façon constante elle est quand même considérable. Le graphique 7 nous montre cette distribution en ce qui a trait à la situation qui prévaut au Canada de 1983 à 1999. Le graphique 8 suivra avec la distribution du nombre d’enlèvements d’une personne de moins de 16 ans au Québec pour ces mêmes années. (Pour trouver toutes les données, voir l’annexe 2)
Graphique 7 : Distribution du nombre d’enlèvements de personne de moins
de 16 ans au Canada de 1983 à 1999
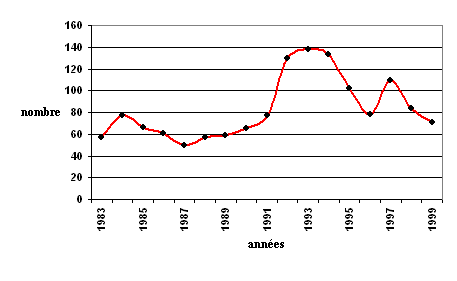
Graphique 8 : Distribution du nombre d’enlèvements de personne de moins
de 16 ans au Québec de 1983 à 1999
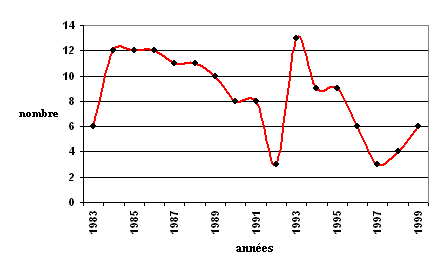
Comme nous pouvons le constater, depuis le milieu des années 1980, le nombre d’enlèvements de personnes de moins de 16 ans a une nette tendance vers le bas, pour atteindre un niveau très bas en 1992. Par la suite, le nombre augmente considérablement pour presque aussitôt rechuter et maintenir cette diminution pendant quelques années. Par contre, depuis 1997, le nombre d’enlèvements de cette catégorie tend à augmenter. La raison de cette remontée nous ait par contre toujours inconnue.
Pour ce qui est du sexe des suspects pour cette catégorie, on peut constater qu’encore une fois les kidnappeurs sont plus souvent des hommes que des femmes pour le Québec et pour le Canada.
Graphique 9 : Distribution du nombre de suspects qui ont commis un enlèvement d’une
personne de moins de 16 ans, selon le sexe, au Canada de 1983 à 1999
Graphique 10 : Distribution du nombre de suspects qui ont commis un enlèvement d’une
personne de moins de 16 ans, selon le sexe, au Québec de 1983 à 1999
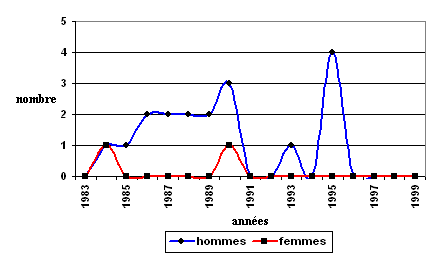
Nous pouvons constater que le nombre de femmes impliquées dans ce crime est très bas pour cette catégorie d’enlèvements. Au Canada le nombre de suspects féminins ne dépasse pas 5 cas et au Québec 1 cas. En ce qui a trait au Canada, on remarque que le nombre de femmes suspectées d’enlèvement demeure relativement stable au cours de toutes ces années. Pour ce qui est du Québec plus particulièrement, il n’y a qu’en 1984 et 1990 où seulement une femme est le suspect pour cette infraction. Quant aux hommes, on ne dénote aucune véritable tendance pour le Québec, alors que pour le Canada le nombre semble vouloir diminuer. Il est cependant à noter que les cas d’enlèvements de personnes de moins de 16 ans sont beaucoup plus rares que tous les autres types d’enlèvements prescrits par la loi. Donc, le nombre restreint de cas emmène évidemment un nombre également restreint d’accusés, ce qui fait en sorte qu’une analyse de ces nombres est plutôt délicate.
Les graphiques suivants font état du nombre d’enlèvements de personnes de moins de 16 ans qui ont été solutionnés, autant pour le Canada que pour le Québec.
Graphique
11 : Distribution des enlèvements d’une
personne de moins de 16 ans qui ont été
solutionnés avec ou sans mise
en accusation au Canada de 1983 à 1999
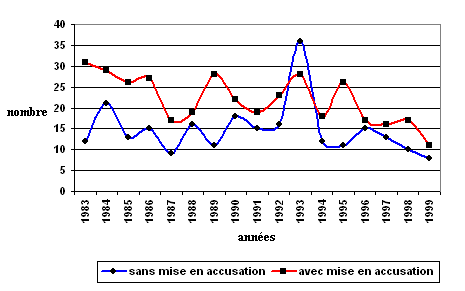
Autant pour ce qui est des crimes solutionnés sans mise en accusation que ceux solutionnés avec mise en accusation, on remarque que les nombres fluctuent beaucoup. On peut cependant affirmer que, malgré une légère exception en 1993, les enlèvements d’une personne de moins de 16 ans solutionnés par mise en accusation sont plus nombreux que les cas où il n’y a pas eu d’accusations portées. On peut également ajouter que depuis le milieu des années 1990, les deux catégories de classement de l’affaire semblent vouloir diminuer, ce qui n’est pas surprenant puisque le nombre de crimes dans cette catégorie d’enlèvement diminue également au Canada. Pour ce qui est du taux de résolution en général, ce dernier fluctue énormément au cours de ces années, pouvant aller de 22.6% à 75.4%. En moyenne, les enlèvements de personnes de moins de 16 ans, au Canada, sont résolus à 48%.
Graphique
12 : Distribution des enlèvements d’une
personne de moins de 16 ans qui ont été
solutionnés avec ou sans mise
en accusation au Québec de 1983 à 1999
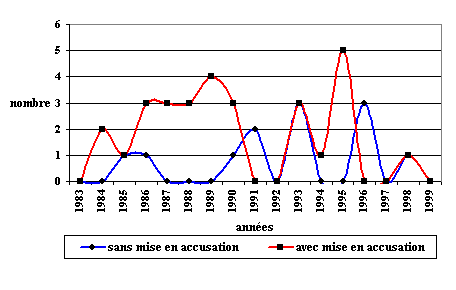
En ce qui concerne le cas du Québec, on remarque encore que peu de cas de ce type d’enlèvement se produisent sur ce territoire. Bien que peu de cas soient reportés, le pourcentage de crimes résolus demeure plutôt faible, atteignant à quatre reprises 0% et obtenant un maximum de 55.6%. Le taux moyen de résolution de ce type d’enlèvements au Québec se situe donc aux alentours de 27%. De plus, le nombre d’enlèvements qui se soldent par une mise en accusation fluctue énormément. La plupart du temps, ces derniers occupent une place prépondérante, mais on voit également qu’à plusieurs occasions les infractions solutionnées sans mise en accusation égalent et même surpassent celles solutionnées par une mise en accusation. On ne peut donc pas relever de tendances spécifiques pour ce qui est du classement de l’affaire pour cette catégorie d’enlèvements.
3) Enlèvements en contravention d’une ordonnance de garde
Cette partie consiste en l’analyse des tendances des enlèvements parentaux en contravention d’une ordonnance de garde. Ce type d’infraction est le plus courant parmi les enlèvements parentaux puisqu’il représente 61,6% de ceux-ci. Les graphiques suivants nous permettent donc d’établir les tendances relatives aux enlèvements en contravention d’une ordonnance de garde au Canada et au Québec.(Voir aussi l’annexe 3)
Graphique 13 : Distribution du nombre d’enlèvements en contravention d’une
ordonnance de garde au Canada de 1983 à 1999
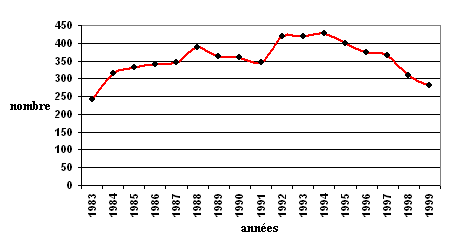
Le nombre peu élevé de cas dans cette catégorie d’enlèvement qu’on retrouvait en 1983 n’a pas encore été égalé depuis. Par contre, bien que les enlèvements en contravention d’une ordonnance de garde accusaient une augmentation constante depuis cette date, on constate que depuis le début des années 1990 ces derniers tendent à diminuer. Cette baisse relativement constante pourrait laisser croire que dans les deux dernières années le nombre de ces enlèvements aurait également chuté pouvant peut-être même atteindre un niveau aussi bas qu’au début des années 1980. Pour ce qui est de l’augmentation à laquelle on a pu assister depuis le début des années 1980, on pourrait associer ceci au fait que le divorce devenait de plus en plus monnaie courante dans notre société. Ainsi, les nombreuses ordonnances de garde favorisant majoritairement la mère ont probablement choqué et déstabilisé plus d’un père qui a, par la suite, commis un enlèvement de son enfant. Quant à la diminution qui suit cette hausse, aucune données ou informations ne nous indiquaient sa cause. Par contre, il est possible que, non pas que les divorces soient moins fréquents mais, que les tribunaux accordent de plus en plus la garde légale au père ou bien que la garde partagée soit devenue plus populaire.
Graphique 14 : Distribution du nombre d’enlèvements en contravention d’une
ordonnance de garde au Québec de 1983 à 1999
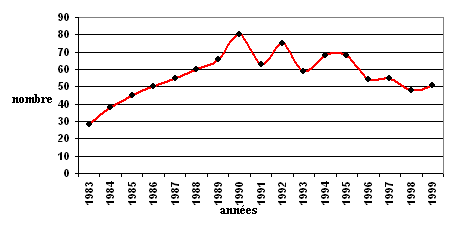
Pour ce qui est de la situation du Québec, on est à même de constater que la tendance est sensiblement la même que pour l’ensemble du Canada. On remarque qu’à partir de 1983, et ce jusqu’en 1990, le nombre d’enlèvements en contravention d’une ordonnance de garde a subi une augmentation stable mais fulgurante. Par la suite, tout comme au Canada, ce type d’enlèvement diminue, malgré quelques petites fluctuations.
Graphique 15 : Distribution du nombre de suspects qui ont commis un enlèvement
en contravention d’une ordonnance de garde, selon le sexe, au Canada de 1983 à 1999
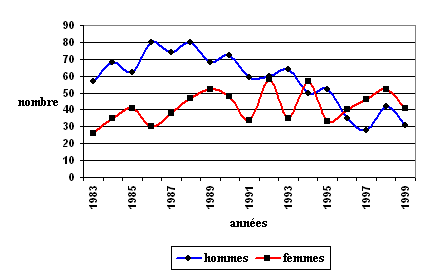
Encore une fois, on remarque qu’en général les hommes sont davantage les auteurs d’enlèvements que les femmes. Cependant, on peut constater que le nombre de femmes qui enlèvent leur enfant, en contravention d’une ordonnance de garde, se rapproche beaucoup plus du nombre de suspects masculins que pour les autres catégories d’enlèvements étudiées jusqu’à présent. Un autre point mérite d’être soulevé, à savoir que le nombre d’hommes qui enlèvent leur enfant en contravention d’une ordonnance de garde semble diminuer alors que le nombre de suspects féminins tend à augmenter. On peut donc supposer que les femmes s’attaquent davantage à leurs propres enfants pour des infractions relatives à l’enlèvement et que ce phénomène se produit de plus en plus. En jetant un coup d ‘œil au graphique 16, on se rend même compte que la situation est sensiblement la même pour ce qui est du Québec.
Graphique 16 : Distribution du nombre de suspects qui ont commis un enlèvement en
contravention d’une ordonnance de garde, selon le sexe, au Québec de 1983 à 1999
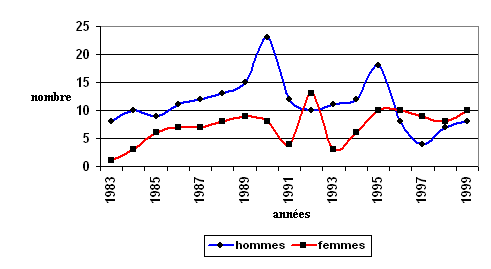
Poursuivons l’analyse des tendances des enlèvements en contravention d’une ordonnance de garde avec les infractions qui ont été solutionnées, soit par mise en accusation, soit sans mise en accusation. Les graphiques suivants font état de ces données.
Graphique
17 : Distribution des enlèvements en
contravention d’une ordonnance de garde qui
ont été solutionnés avec ou
sans mise en accusation au Canada de 1983 à 1999
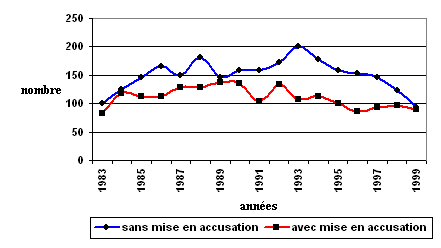
Pour le Canada, on remarque qu’étonnamment, les infractions solutionnées sans mise en accusation se retrouvent en plus grand nombre que celles solutionnées avec mise en accusation. On voit également que la tendance des deux types de classement de l’affaire est en diminution et qu’en 1999, les deux courbes se rejoignent. Bien que le fait que davantage d’enlèvements en contravention d’une ordonnance de garde soient solutionnés sans mise en accusation semble plutôt étrange, une hypothèse pourrait potentiellement expliquer ce phénomène. En effet, comme il s’agit ici d’un parent qui kidnappe son propre enfant, on peut comprendre que dans plusieurs cas l’enfant est ramené auprès de l’autre parent et que ce dernier ne porte pas nécessairement d’accusations envers l’ex-conjoint (e). Par contre, le graphique 18 nous indique que cette tendance ne se retrouve pas au Québec. En effet, on constate qu’en territoire québécois, la plupart des enlèvements en contravention d’une ordonnance de garde sont classés par mise en accusation. Pour ce qui est des taux de solution de ce type d’enlèvement, en moyenne, au Canada, 74% de ces crimes sont solutionnés alors qu’au Québec cette proportion est de et de 77%. Les pourcentages d’enlèvements en contravention d’une ordonnance de garde qui sont résolus sont impressionnants si on les compare aux chiffres dont il était question pour les deux types d’enlèvements précédents. Par contre, cet écart peut s’expliquer par le fait que comme ces enlèvements sont perpétrés par un des parents, il est peut-être plus facile pour la police de connaître, dans ces cas, l’identité de l’agresseur et sa localisation.
Graphique
18 : Distribution des enlèvements contravention
d’une ordonnance de garde qui
ont été solutionnés avec ou
sans mise en accusation au Québec de 1983 à 1999
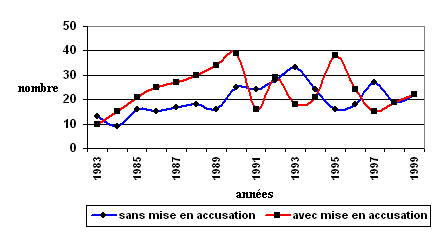
4) Enlèvements en l’absence d’une ordonnance de garde
Entre 1983 et 1999, il y a eu 3756 enlèvements en l’absence d’une ordonnance de garde au Canada (voir annexe 4). Ce chiffre, quoique énorme, semble suivre la tendance générale qui est la hausse du nombre d’enlèvements, suivie d’une baisse au début des années 1990. C’est à partir de 1992 que le nombre d’enlèvements en l’absence d’ordonnance de garde a commencé à chuter. Cette tendance reflète ce que nous avons déjà observé dans les autres cas d’enlèvements au Canada.
Graphique 19 : Distribution du nombre d’enlèvements en l’absence d’une
ordonnance de garde au Canada de 1983 à 1999
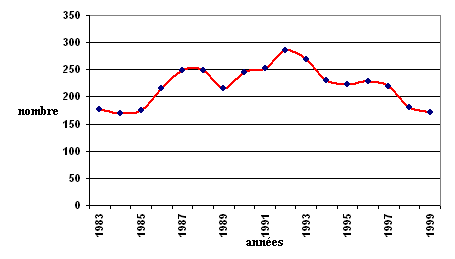
Graphique 20 : Distribution du nombre d’enlèvements en l’absence d’une
ordonnance de garde au Québec de 1983 à 1999
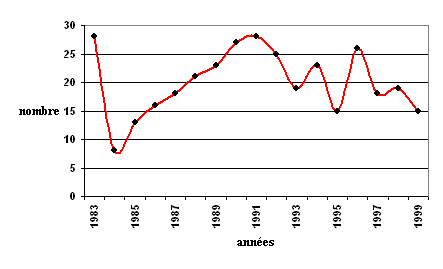
En ce qui concerne le Québec,
on remarque des fluctuations importantes au cours des années. Premièrement,
entre 1983 et 1984, le nombre d’enlèvements en l’absence d’une ordonnance de
garde a chuté considérablement, passant de 28 à 8 cas. Par la suite, et ce
jusqu’en 1991, une hausse constante du nombre d’infractions survient pour
ensuite commencer à prendre une légère tendance vers le bas, malgré quelques
fluctuations importantes. Par contre, ces changements, d’année en année,
peuvent avoir l’air démesurés, mais il faut toujours garder en tête que le
faible nombre d’enlèvements qui surviennent chaque année au Québec explique
cette situation.
En ce qui concerne le sexe des ravisseurs, encore une fois, il y a des différences considérables entre le Québec et le Canada. Nous pouvons constater avec le graphique 21 que pour le Canada, les hommes enlèvent plus souvent des enfants en l’absence d’une ordonnance de garde comparativement aux femmes. Mais on s’aperçoit aussi qu’à partir de 1987, cette tendance est à la baisse.
Graphique 21 : Distribution du nombre de suspects qui ont commis un enlèvement en
l’absence d’une ordonnance de garde, selon le sexe, au Canada de 1983 à 1999
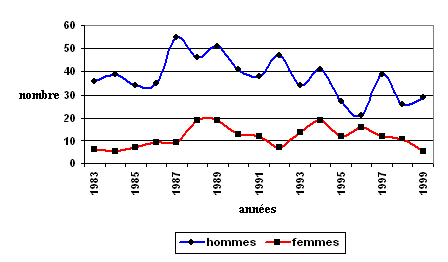
Pour le Québec, on peut constater, en regardant le graphique 22, qu’il y a plusieurs variations dans les tendances. Pour les femmes, entre 1983 et 1989, on constate qu’il y a une hausse du nombre d’enlèvements et à partir de 1989 il y a une baisse qui est plutôt constante. Pour les hommes, la hausse est présente jusqu’en 1992 et le nombre de suspects masculins baisse par la suite de façon instable. Les hommes sont tout de même plus souvent les auteurs d’enlèvement que les femmes et cela peut s’expliquer par le fait que les femmes reçoivent plus souvent la garde légale des enfants que les hommes.
Graphique 22 : Distribution du nombre de suspects qui ont commis un enlèvement en
l’absence d’une ordonnance de garde, selon le sexe, au Québec de 1983 à 1999
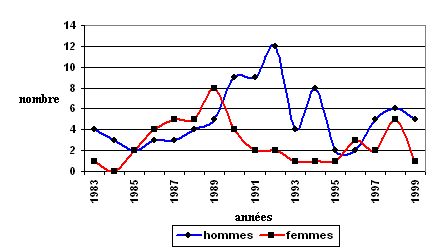
En ce qui a trait aux crimes qui sont solutionnés, dans le cas des deux types d’enlèvement parentaux, les dossiers sont plus souvent réglés sans aucune mise en accusation des auteurs de l’acte. Ce qui peut signifier que les tribunaux sont un peu plus cléments avec les kidnappeurs qui ont un lien parental avec l’enfant que des kidnappeurs qui ne sont ni parent ni tuteur de l’enfant. Un autre cas peut également expliquer le fait que davantage d’enlèvements soient classés sans mise en accusation, soit lorsque le parent a commis son acte dans le seul intérêt de l’enfant. Quant au taux de résolution global, au Canada, on constate que comme pour l’autre type d’enlèvement parental, beaucoup de crimes sont solutionnés par les autorités. En effet, 67% des ces enlèvements sont résolus, en moyenne. Pour le Québec, ce taux moyen se chiffre à 78%.
Graphique
23 : Distribution des enlèvements en
l’absence d’une ordonnance de garde qui
ont été solutionnés avec ou
sans mise en accusation au Canada de 1983 à 1999
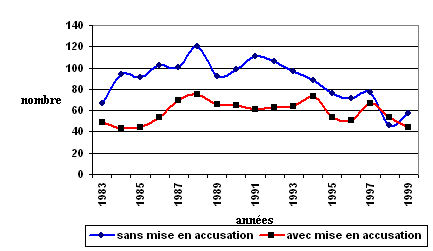
Graphique
24 : Distribution des enlèvements en
l’absence d’une ordonnance de garde qui
ont été solutionnés avec ou
sans mise en accusation au Québec de 1983 à 1999
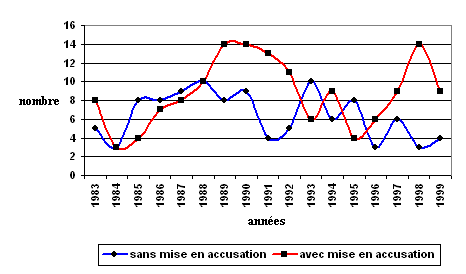
Au Québec, en ce qui concerne les rapts parentaux en l’absence d’une ordonnance de garde, on remarque que les deux types de résolution se chevauchent énormément. Par contre, on peut dire que plus d’enlèvements faisant partie de cette catégorie sont résolus avec mise en accusation, contrairement à ce qui se passe pour l’ensemble du Canada. Les causes auxquelles nous pouvons attribuer cette différence ne nous semblent pas claires. Peut-être que les juges québécois sont moins indulgents envers les parents kidnappeurs? Peut-être que les circonstances des enlèvements sont telles qu’il est impératif d’user d’une mise en accusation pour punir les suspects? Pour l’instant, nos questions demeurent sans réponse …
5) Enlèvements et/ou séquestrations
Passons finalement à la dernière catégorie d’enlèvements dont il est question dans ce travail, c’est-à-dire les enlèvements et/ou séquestrations. Les enlèvements et les séquestrations ne suivent aucunement la tendance des autres types d’enlèvements. Le tableau suivant démontre la tendance de ce type de crime, une tendance qui lui est particulière. (Consultez également l’annexe 5)
Graphique 25 : Distribution du nombre d’enlèvements et/ou de séquestrations
au Canada de 1983 à 1999
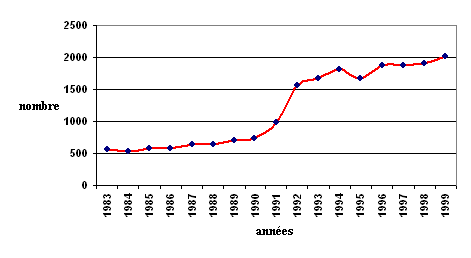
Contrairement aux quatre autres types d’enlèvements, nous pouvons constater avec le graphique 25 que le nombre d’enlèvements et/ou de séquestrations est en hausse constante et continue, avec une grande remontée au début des années 1990. Peu d’informations dans la littérature nous donnent des indices à savoir quelle pourrait être la cause d’une telle augmentation constante des enlèvements avec séquestration au Canada. Regardons ce qui est en pour le Québec.
Graphique 26 : Distribution du nombre d’enlèvements et/ou de séquestrations
au Québec de 1983 à 1999
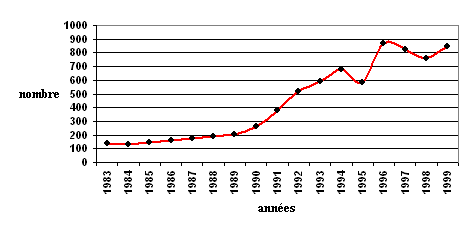
On voit donc que pour le Québec, la courbe est pratiquement la même qu’au Canada en entier. En effet, on constate la même hausse constante dès 1983, avec le même petit creux en 1995 pour assister ensuite à une remontée du nombre d’enlèvements et/ou séquestrations dès l’année suivante. La tendance semble d’ailleurs toujours se diriger vers le haut.
En ce qui concerne le sexe des
suspects, regardons les tableaux suivants pour avoir une idée des tendances
pour le Canada et le Québec.
Graphique 27 : Distribution du nombre de suspects qui ont commis un enlèvement et/ou une
séquestration, selon le sexe, au Canada de 1983 à 1999
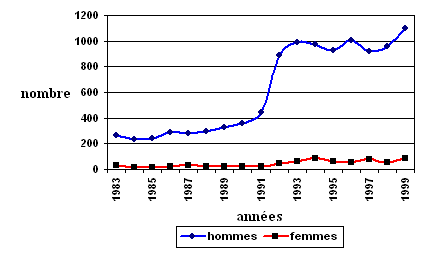
Graphique 28 : Distribution du nombre de suspects qui ont commis un enlèvement et/ou
une séquestration, selon le sexe, au Québec de 1983 à 1999
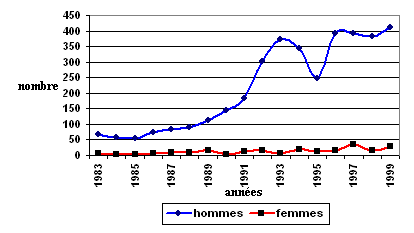
Dans les deux cas, on constate avec
évidence que le nombre de femmes suspectées d’enlèvements avec séquestration
reste très stable et très bas au cours de toutes ces années. Par contre, le
nombre de suspects masculins varie fortement. On peut même affirmer que ce
nombre varie en même temps que la hausse du nombre de délits, autant au Québec
qu’au Canada. Cela s’explique bien entendu par le fait que les hommes sont
presque en totalité les accusés dans les histoires d’enlèvements et/ou
séquestrations. Il est donc normal que la courbe du nombre de suspects
masculins suive celle du nombre total d’infractions.
En ce qui a trait aux enlèvements et/ou séquestrations qui ont été solutionnés au Canada de 1983 à 1999 (en moyenne à 68%), on remarque qu’à chaque année, moins de 200 cas se soldent sans mise en accusation. Cette tendance demeure constante et stable tout au long de la période étudiée. Quant aux infractions solutionnées par mise en accusation, on peut faire le même constat que pour la distribution des suspects masculins, c’est-à-dire que la courbe suit la même tendance que le nombre de crimes en général. Ceci peut alors s’expliquer par le fait que ce type d’enlèvement est considéré comme étant plus grave, particulièrement parce qu’il comporte également l’infraction de séquestration. Contrairement aux enlèvements parentaux devant lesquels les juges peuvent se permettre d’être un peu plus cléments, les accusés dans les cas d’enlèvements avec séquestration ne peuvent bénéficier d’une aussi grande indulgence de la part des tribunaux.
Graphique
29 : Distribution des enlèvements et/ou
séquestrations qui ont été
solutionnés avec ou sans mise
en accusation au Canada de 1983 à 1999
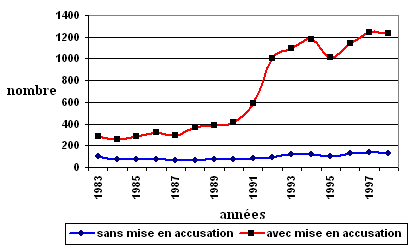
Graphique
30 : Distribution des enlèvements et/ou
séquestrations qui ont été
solutionnés avec ou sans mise
en accusation au Québec de 1983 à 1999
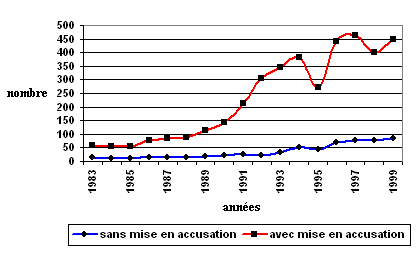
Pour le Québec, on remarque sensiblement les mêmes tendances que pour le Canada, quoique les enlèvements et/ou séquestrations classés sans mise en accusation montrent une légère croissance vers le milieu des années 1990. Pour ce qui est des événements solutionnés par mise en accusation, on constate que la courbe suit pratiquement la même voie que pour l’ensemble du Canada. Quant au pourcentage moyen de résolution des crimes, il se situe autour de 59%.
SYNTHÈSE
On a donc pu constater, tout au long de cette section, que peu d’enlèvements se produisaient au Québec, relativement à l’ensemble du Canada. De plus, la catégorie enlèvements et/ou séquestrations est celle qui comporte le plus d’événements. Pour ce qui est des tendances, en général, les quatre premiers types d’enlèvement semblent être à la baisse depuis quelques années, alors que les enlèvements et/ou les séquestrations sont en progression importante et constante. Par contre, la cause de l’expansion de ce type d’infractions demeure inconnue.
Pour ce qui est du sexe des suspects, on a évidemment constaté que les hommes sont, encore une fois, sur représentés parmi les agresseurs, et ce pour chaque catégorie d’infractions. D’ailleurs, ces résultats sont confirmés par les informations recueillies dans la littérature sur le sujet.
Finalement, pour les crimes solutionnés, on a pu voir que les enlèvements parentaux sont les types d’enlèvements qui obtiennent les plus hauts taux de résolutions, tout en étant la catégorie où on retrouve le plus de crimes solutionnés sans mise en accusation. Ceci est probablement du au fait que l’agresseur est dans ce cas bien précis un des parents de la victime.